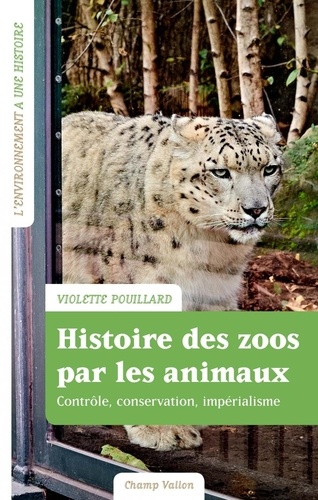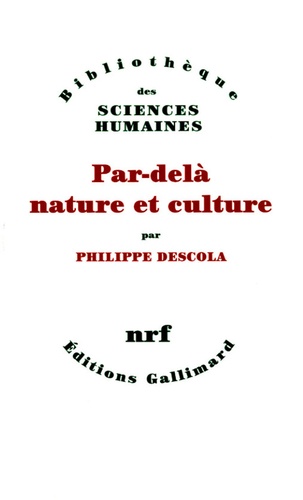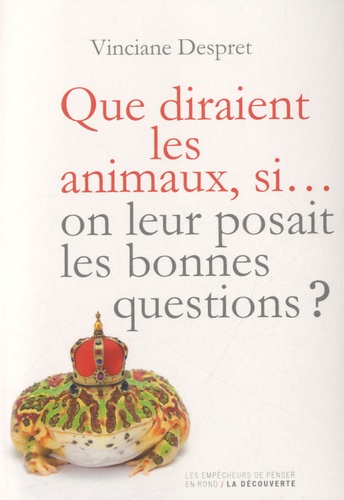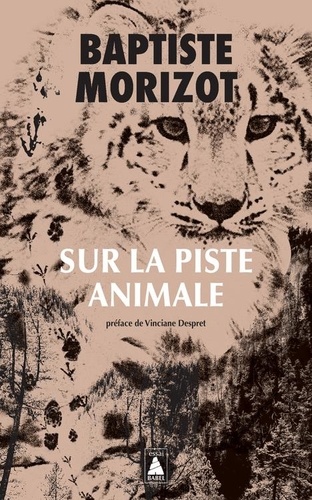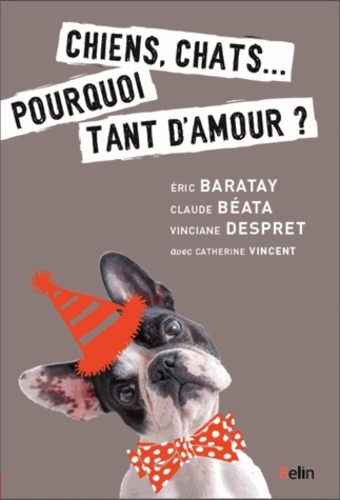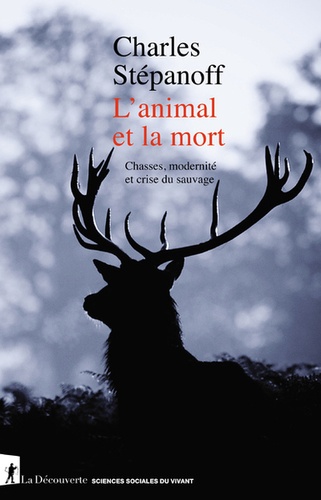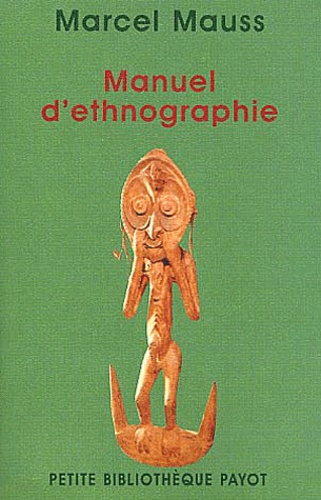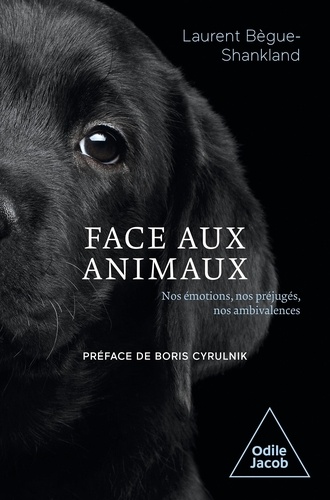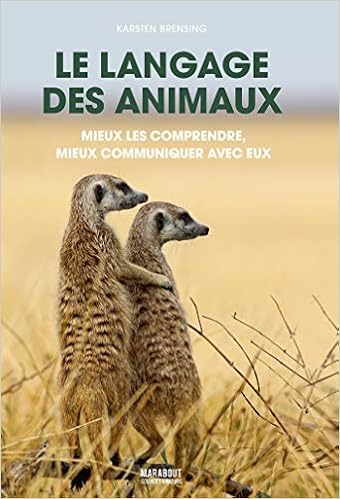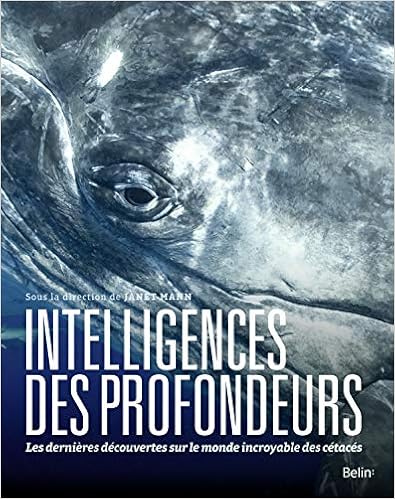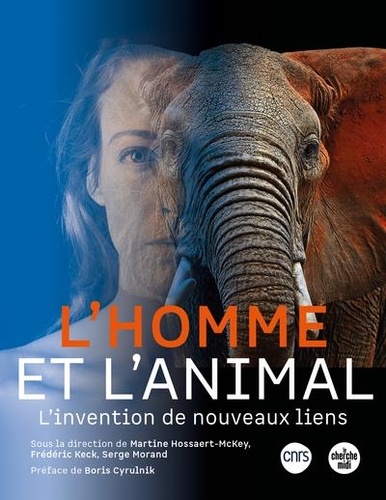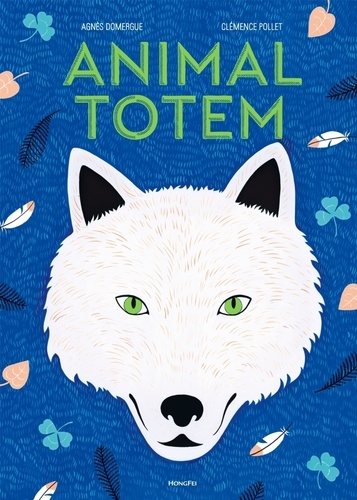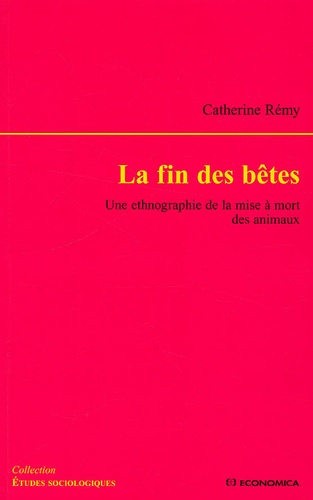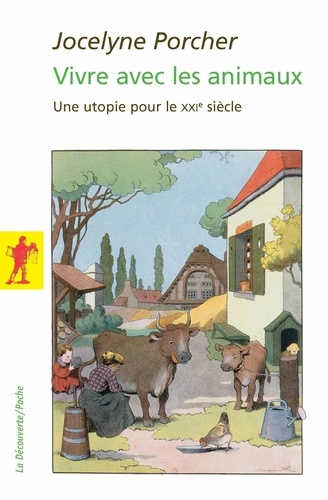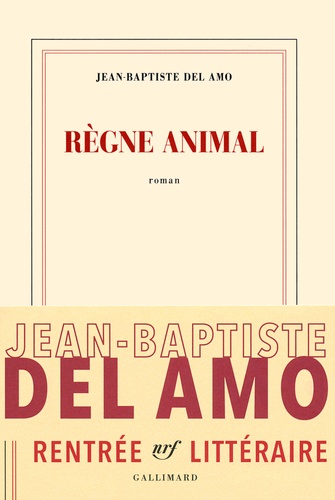Animaux et humains, à la vie à la mort

Novembre, le mois de l’année où les morts se rappellent à notre souvenir. Le mois des lectures horrifiques, des atmosphères fantastiques, des nuits de plus en plus sombres, du brouillard et du froid qui s’installe. La nature entre en veille, les couleurs se grisent, les plantes se mettent en sommeil. Une période de rites, cimetières et fleurissements, qui invite à se pencher, à l’occasion de la programmation Métamorphoses : l’homme et l’animal, sur le double rapport de l’animal et de l’humain à la mort. Car cette dure mais inévitable réalité introduit une réciprocité : elle infuse en l’humain un rapport au biologique pas toujours assumé, une fragilité, une fatalité, et dans le même temps elle confère à l’animal une humanité, une dimension émotionnelle et rituelle indéniables. Par-delà les grands questionnements, - l’animal est-il une personne ? L’homme doit-il regarder en face sa part animale ? -, il s’agit avant tout pour ces deux-là d’apprendre à vivre et mourir ensemble. Une problématique que notre monde contemporain s’emploie à revisiter, en interrogeant ce qu’humains et animaux ont en partage.
C’est d’abord à travers le prisme de l’homme responsable de la mort de l’animal, attesté historiquement et culturellement par un lien étroit d’interdépendance mutuelle, ensuite par la relation de l’animal lui-même à la mort de ses semblables, relation que les récentes recherches comportementalistes révèlent comme plus porteuse de sens qu’on le supposait, que nous aborderons ce sujet.
Une mort codifiée, sublimée ou dissimulée
Outre le fait que l’action humaine sur l’écosystème provoque directement ou indirectement la disparition de nombreuses espèces animales, l’homme a toujours tué les animaux : pour se nourrir, se vêtir, dans le cadre de la recherche scientifique, voire pour d’autres motifs plus obscurs. Une « violence anthropique » que l’anthropologue Charles Stépanoff évoque dans L’animal et la mort. Cette violence recouvre une exploitation de la nature, parfois dissimulée sous l’apparence d’un amour de la faune, tels les deux visages de Janus. L’homme dévaste la forêt et crée des réserves naturelles, le chasseur régule la prolifération animale mais au profit d’autres populations et activités humaines.
Cette violence recouvre par ailleurs une dimension bien plus sombre, liée à la gestion et la production capitalistes. L’abattage industriel coupe l’humain de son rapport direct à l’animal, créant une dissociation avec le vivant ; ceci allant jusqu’à susciter une souffrance chez certains éleveurs. Comme le souligne Jocelyne Porcher, éleveuse elle-même, dans son essai Vivre avec les animaux : « Les éleveurs souhaitent autre chose pour leurs animaux que l’abattoir industriel ». Ce fonctionnement d’un abattage industriel éloigné de toute visibilité, préservant ainsi la bonne conscience des citoyens de la vision de ce qui est devenu de nos jours impensable, suscite de plus en plus de rejet et de questionnements, notamment dans l’objectivation portée sur l’animal.


La chasse, autre dimension attachée à la mort des animaux, est de nos jours avant tout envisagée comme un loisir, une pratique marquée par la séparation de l’animal et de l’homme. Initialement surtout liée à la survie, cette pratique ne semble avoir gardé au fil des siècles que peu de lien avec la motivation initiale de trouver sa nourriture. Il s’agirait aujourd’hui avant tout d’un hobby, voire d’un sport déconnecté de toute utilité, gratuit. C’est cependant plus compliqué car, en territoire rural, cette pratique n’est pas détachée de la recherche de nourriture, encore aujourd’hui ; cela a été également une réalité en temps de guerre. Au-delà du « sport », un lien d’interdépendance perdure, rapprochant l’homme de l’animal, soulignant son état de carnivore.
D’autres aspects contrebalancent cette vision de la chasse comme éloignement, rupture avec l’animal, volonté d’asseoir une domination qui séparerait l’humain de sa part biologique. Au-delà de l’argument prenant appui sur le motif de la préservation et de l’entretien de l’écosystème, de la régulation des espèces par le chasseur qui peut laisser place au scepticisme, il est vrai que la chasse est une pratique ancestrale, artisanale, en osmose avec la nature, très éloignée de l’aspect mécanique de l’industrie de l’abattage. Les formes historiques et culturelles de cette pratique sont multiples : battue, affût, vénerie, fauconnerie, chasse paysanne. Elles sont de plus étayées par un terreau social, des communautés restreintes, de la chasse à courre de la noblesse au mode de vie de groupes ruraux. Un rapport bien spécifique à l’animal que Charles Stépanoff synthétise ainsi : « ancré dans son propre monde, l’animal-gibier n’est ni sacralisé comme un animal-enfant ni transformé en animal-matière ». Pour ses détracteurs, la chasse induirait la confrontation, le face à face de l’homme avec l’animal, intégrant le respect de ce dernier. L’affrontement, car l’issue n’est pas toujours certaine… Et une intimité, presque : « L’individu ne va pas à la chasse. Il va à la chasse au lièvre ; et non pas à la chasse au lièvre mais à la chasse de tel lièvre, qu’il connaît bien » Marcel Mauss, Manuel d’ethnographie, 1926
Cette question de la proximité peut prendre une dimension plus impressionnante et interroger sur la part d’animalité de l’homme révélée à travers des rites ancestraux d’échange, voire de transformation. Ces rituels, porteurs d’une part symbolique de sauvagerie semblent refaire surface dans les sociétés contemporaines. C’est le cas du « baptême du chasseur » en vigueur dans le nord-est de la France, qui consiste, dans sa forme la plus édulcorée, à barbouiller le visage du jeune chasseur du sang du premier animal tué. Un rite de passage inspiré de cérémonies initiatiques plus anciennes (le blooding ritual, encore en vigueur de nos jours dans la noblesse anglaise) où le chasseur cherche ainsi à s’approprier la puissance de l’animal tué. De manière plus ancienne encore, des peuples avaient coutume de manger le cœur cru de l’animal chassé, de conduire une cérémonie autour de la dépouille de l’ours, d’en revêtir la peau. Une autre tradition est encore vivace, liée cette fois au besoin de remercier l’animal, de lui rendre hommage en déposant une branchette d’arbre dans la bouche de ce dernier. Présente chez les Inuits, elle apparaît comme un contre-don qui permet de le nourrir symboliquement.
Ces multiples rites explorent tout un panel de relations symboliques entre l’homme et l’animal, qui allie proximité, intimité, fascination et répulsion. Une pensée de la métamorphose transparaît, que l’on peut dire constitutive d’une forme d’animalité de l’humain, d’appropriation de sa part sauvage, que les carnavals européens, les mythes traduisaient également par la création de figures hybrides, effrayantes, parodiques.
Cependant, il est à noter que ces phénomènes ne sont structurés que du seul point de vue de l’humain et ne prennent à aucun moment en compte le ressenti de l’animal. Ce dernier se trouve réduit à un objet, une proie, voire un produit. Il devient alors indispensable de s’interroger sur sa propre perception de la mort et des émotions qui lui sont liées.


L'animal ressent, comprend, se souvient
« Il faut être cognitivement généreux avec les animaux pour savoir ce qu’ils sont capables de faire » Dominique Lestel à propos du travail de Vinciane Despret.
Les philosophes occidentaux ont pour l’ensemble longtemps estimé que l’animal n’était pas conscient de la mort. Jean-Jacques Rousseau déclare que « jamais l’animal ne saura ce que c’est que mourir » (Discours sur les fondements et l’origine de l’inégalité parmi les hommes), Arthur Schopenhauer assure que « l’animal n’a idée de la mort que dans la mort même » (Le monde comme volonté et représentation) après Malebranche clamant que « les animaux mangent sans plaisir, ils crient sans douleur, ils croissent sans savoir, ils ne désirent rien, ils ne craignent rien, ils ne connaissent rien ». Le concert est tonitruant.
Et pourtant, sans céder aux mythes fantaisistes tel celui du cimetière des éléphants, cette approche a fortement évolué au cours du XXème siècle, chez les penseurs (Gilles Deleuze, Vinciane Despret, Jacques Derrida, ...) comme chez les scientifiques. Les éthologues et comportementalistes constatent de plus en plus que les comportements des animaux face à la mort sont sources d’enseignement. Cynthia Moss écrit dans La longue marche des éléphants : « Rassemblés autour du cadavre de Tinia, ils l’effleurèrent doucement de la trompe et des pieds… Ils essayèrent de creuser… et lorsqu’ils parvenaient à ramasser un peu de terre, ils la répandaient sur le corps de Tinia…. Quelques autres s’éloignèrent pour aller casser des branches… et les déposèrent sur le cadavre… Puis ils la veillèrent pendant la plus grande partie de la nuit ». Barbara J. King dans Le respect des morts montre que lors de l’agonie de l’un des leurs les ouistitis expriment « un souci compassionnel ainsi que des systèmes de liens entre pairs ». Chez les babouins, des comportements d’isolement social, de perte d’assurance ont pu être constatés après un décès. Un bébé dauphin mort a été maintenu à flot six jours par sa mère, escortée d’une vingtaine de dauphins.
De nombreux témoignages de personnes vivant au contact des animaux ou spécialistes de leur comportement, vont dans ce sens. Ils enrichissent les récentes découvertes des biologistes et éthologues qui mettent en évidence le sens de la causalité et de l’intentionnalité chez les grands singes mais aussi chez les oiseaux. Des hiérarchies matrilinéaires et une connaissance des liens familiaux ont été constatées chez les macaques et babouins. Ainsi que l’existence de liens sociaux puissants chez les éléphants. Les corbeaux montrent des aptitudes à la mémoire, l’émotion, l’empathie, l’apprentissage.
Les émotions et la souffrance animales sont de plus en plus reconnues même si la recherche sur l’éthique animale a 20 ans de retard sur la recherche scientifique. Il apparaît en effet difficile d’admettre que l’humain ne se situe plus au sommet de l’échelle du vivant mais qu’il n’en est qu’une incarnation spécifique, différente mais pas forcément supérieure. Et pourtant l’observation de ces comportements face à la mort introduit une part commune, une passerelle entre l’homme et l’animal qui, avec l’identification d’un langage, d’une mémoire, de comportement acquis, signent une parenté évidente.

Écouter les animaux
De la proximité sanglante de la chasse impliquant que l’humain intègre et endosse, pas forcément consciemment, une part d’animalité à la conscience chez les animaux d’une mort à venir qui les fait accompagner, signifier la séparation et les rend étrangement humains dans leurs comportements, on peut tirer la conclusion que ce lien indéfectible est une infinie richesse. Il nous invite à réinterroger les pratiques productivistes qui visent à masquer la réalité de la mort animale : des éleveurs, à l’instar de Jocelyne Porcher ou Noémie Calais (Plutôt nourrir : l’appel d’une éleveuse) militent pour la réappropriation par les paysans de la mort des animaux qu’ils ont élevés. Jocelyne Porcher écrit : « L’abattage des animaux ne doit pas être assumé par des travailleurs portant à eux seuls la responsabilité de la mort des animaux. Les animaux d’élevage sont un lien commun, et lorsque ce lien est dénoué, c’est à nous tous qu’incombe la responsabilité de leur mort. » Car il s’agit bien là de responsabilité des humains face au vivant.
Enfin, même si des scientifiques sceptiques peuvent accuser ceux qui mènent des recherches sur l’animal et l’empathie d’anthropomorphisme, il n’en demeure pas moins que le fait de mieux comprendre le deuil chez les animaux permettra d’améliorer leur bien-être dans toutes les circonstances de notre vie en commun. Et du côté des humains, comprendre notre animalité fait gagner en humanité. Car la séparation, mortifère, le rapport utilitariste qui objective l’animal crée une rupture préjudiciable à la générosité et aux enseignements à retenir de la nature.
Il s’agit de rétablir un rapport au monde partagé et commun, de sauver, comme l'écrit Jocelyne Porcher, « notre capacité à entrer dans le monde des animaux et à changer de point de vue. Car vivre avec les animaux nous transforme. Les animaux nous éduquent et nous donnent des compétences dont nous nous pensions dépourvus ».
Une utopie ?
Animaux et humains

Quand les animaux nous font du bien : enquête sur ces compagnons qui rendent nos vies meilleures
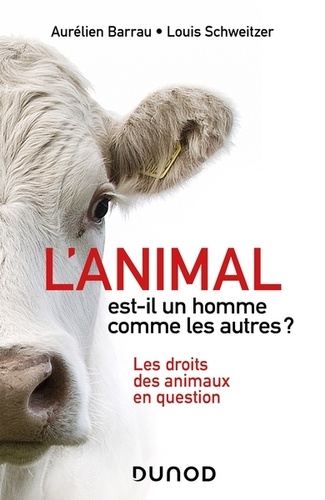
L'animal est-il un homme comme les autres ? : les droits des animaux en question